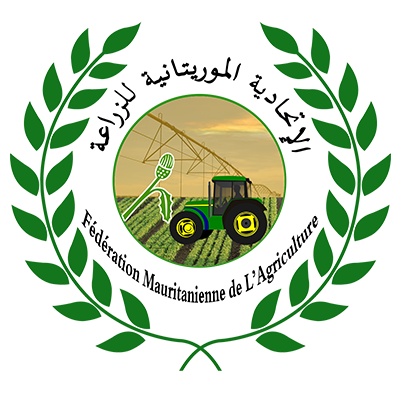Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diay a présidé lundi 14 Juillet 2025 une réunion avec la Fédération nationale de l’Agriculture conduite par son président Adama Oumar Dia, en présence du président de l’Union nationale du Patronat mauritanien, M. Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed.
14 JUILLET 2025


Dans son allocution, à l’entame de la réunion, Monsieur le Premier ministre a indiqué que cette réunion intervient en application des directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, visant à rencontrer les différentes composantes du patronat et à écouter les obstacles auxquels se heurte le secteur privé national.
Le Président de la Fédération Mauritanienne de l’Agriculture a fait dans son exposé introductif, le plaidoyer pour une agriculture au service du développement engageant les petits et moyens agriculteurs de l’irrigué, du pluvial, de l’agriculture oasienne, de l’agro business et les acteurs dans le secteur de la production et de la transformation. Le document de plaidoyer a été remis à Monsieur le Premier Ministre.
L’exposé du président de la Fédération a été suivi de quelques interventions des membres de la Fédération. Les interventions ont tourné au tour du contenu du plaidoyer dans ses aspects liés au financement, à l’énergie, à l’eau, aux équipements de récolte, notamment, aux infrastructures de stockage, de conservation pour la production maraichère qui connait un essor considérable, au désenclavement des zones de production, à la commercialisation, à la protection de la production nationale de riz et de façon saisonnière celle des légumes.
Dans leurs interventions les intervenants ont aussi loué les efforts considérables déployés par l’Etat pour promouvoir le développement du secteur agricole et ont marqué leur satisfaction pour la campagne agricole en cours et ont rassuré sur le niveau de la récolte.
Dans son mot de clôture de la réunion, le Premier ministre a rappelé que l’agriculture revêt une importance particulière pour Son Excellence le Président de la République en raison de l’objectif stratégique de la souveraineté alimentaire. Par conséquent, les directives données au gouvernement sont de soutenir positivement ce secteur vital et de fournir tout ce qui est nécessaire à sa réussite, ce qui a amené le gouvernement à répondre aux demandes qui lui ont été présentées lors de la dernière réunion avec la Fédération il y a huit mois et à poursuivre la même approche à l’avenir.
Le Premier ministre souligné que l’intérêt du secteur est de servir le citoyen mauritanien et faciliter sa subsistance, ce qui est un objectif sur lequel tout le monde doit travailler et le gouvernement ne manquera pas de mettre en œuvre toutes les garanties qui devraient permettre l’atteinte de cet objectif stratégique.
Discours oral — Plaidoyer pour une politique agricole forte en Mauritanie
Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie de nous donner l’opportunité de porter à votre attention les préoccupations majeures du secteur agricole en Mauritanie.
Nous vivons dans un monde en mutation, marqué récemment par la pandémie de Covid-19. Cette crise a mis en lumière notre dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, en particulier pour notre alimentation. Elle nous a aussi enseigné une leçon précieuse : la souveraineté alimentaire n’est plus un luxe, c’est une nécessité.
- Pourquoi l’autonomie alimentaire est-elle cruciale ?
Notre pays possède de grands atouts agricoles : des ressources hydriques abondantes, des terres fertiles et un climat favorable. Et pourtant, pendant longtemps, nous importions la majeure partie de notre alimentation. Aujourd’hui, grâce à une politique volontariste, nous avons fait des progrès, notamment dans la production rizicole.
Mais ces progrès restent fragiles. L’autosuffisance ne se décrète pas : elle se mesure à l’existence d’un stock stratégique capable de couvrir au moins trois années de consommation. Sans cela, le moindre aléa climatique ou économique pourrait tout remettre en cause.
C’est pourquoi nous appelons à une politique de constitution de réserves et à la valorisation de nos cultures traditionnelles comme le sorgho, le maïs ou le niébé, mieux adaptés à notre environnement.
- La réussite de cette politique repose sur un engagement collectif
L’État, les agriculteurs et les transformateurs ont chacun un rôle à jouer.
L’État protège, subventionne et aménage les terres. Mais cela ne suffit pas. Le soutien phytosanitaire reste insuffisant, et l’accès au crédit est trop limité. Aujourd’hui, ce sont les usiniers qui financent en grande partie les campagnes agricoles, à hauteur de 40 milliards d’ouguiyas, comblant le vide laissé par un système bancaire peu adapté.
Ce financement informel, aussi utile soit-il, doit être encadré pour éviter toute dérive, et pour protéger les petits agriculteurs.
- Les défis sont encore nombreux
D’abord, des problèmes structurels freinent notre élan. Nous manquons d’un régime foncier clair, qui permettrait d’utiliser la terre comme garantie. Nous manquons aussi d’un système financier solide, capable de soutenir les investissements agricoles.
Ensuite, il y a les problèmes fonctionnels : l’énergie est chère et inadaptée. Il est temps de raccorder les zones agricoles à l’électricité, afin de réduire les coûts de production.
Il faut également investir dans l’irrigation, les infrastructures, les mécanismes de conservation, de transformation et d’exportation.
- Une stratégie globale : produire, gérer, commercialiser
Produire mieux, grâce à des semences de qualité, des études de sol approfondies, et une intensification raisonnée de l’agriculture.
Gérer mieux, avec des comptes d’exploitation rigoureux, conformes au plan comptable national.
Et enfin, commercialiser intelligemment, à travers la création d’une autorité de régulation du marché agricole, qui protège les producteurs nationaux contre la concurrence étrangère et assure la distribution efficace des produits.
Conclusion
Monsieur le Premier ministre,
L’agriculture n’est pas une simple activité économique. C’est une question de survie, de dignité, de souveraineté.
Aujourd’hui, la Mauritanie a une occasion historique. Nos récoltes couvrent nos besoins annuels. Mais il ne faut pas s’en contenter. Il faut aller plus loin, construire un système agricole résilient, productif et équitable.
Cela nécessite un soutien fort et constant de l’État : subventions, incitations, investissements. Et cela exige aussi que les agriculteurs puissent travailler sans craindre les aléas du marché, assurés que leurs excédents seront valorisés.
Nous avons la terre. Nous avons l’eau. Nous avons la volonté. Il ne manque qu’un dernier pas politique et financier pour atteindre enfin cette souveraineté alimentaire que nous appelons de tous nos vœux.
Je vous remercie.
Problèmes à soumettre à Monsieur le premier Ministre par la fédération mauritanienne de l’agriculture
La pandémie de Covid-19 et les perturbations qu’elle a engendrées au niveau du commerce international ont mis en évidence la nécessité d’acquérir plus d’autonomie, au plan alimentaire notamment. Ainsi l’agriculture est devenue un axe majeur de notre politique de développement. L’État s’est engagé à cet effet à promouvoir la production nationale à travers des mesures attractives d’incitations et de protection d’impacts hautement positifs. Aussi on note à tous les niveaux des avancées significatives qu’il importe de conforter par la résolution de problèmes d’ordre structurel et fonctionnel qu’a révélé un parcours balbutiant mais décisif. La saison hivernale écoulée a été marquée par des inondations sans précédent aux conséquences désastreuses qu’on ne peut occulter.
1 – Nécessités d’autonomie:
Notre pays dispose d’énormes potentialités dans le domaine agricole. D’importantes ressources hydriques, des sols arables de grande qualité et un climat favorable constituent autant d’atouts enviables. Comble de paradoxe, nous importions, il y a peu, l’essentiel des composants de notre assiette. Aujourd’hui de par une orientation audacieuse nous avons réduit de manière considérable notre dépendance vis-à-vis du commerce extérieur.
Dans le domaine rizicole nous avons atteint un niveau où, en années normales, sans aléas, nous parvenons à couvrir nos besoins. Cela nous engage dans la voie de l’autosuffisance.
Il y a à ce niveau une contradiction de taille qu’il importe de lever. On ne devrait parler d’autosuffisance que lorsque l’on constate l’existence d’un stock pouvant couvrir les besoins de 3 ans au moins après que la demande annuelle ait été satisfaite. Autrement l’existence d’un filet de sécurité est nécessaire pour pallier les difficultés de tous ordres, inhérentes à l’activité agricole, pour le moins aléatoire.
Il convient de souligner que la production de riz, jugée plutôt satisfaisante, résulte de l’extension des emblavures plus que du taux de rendement. Un tel état de fait tendrait plutôt à accroître les charges d’exploitation.
Aussi par rapport au riz asiatique, quoi qu’importante, notre production ne peut être compétitive. Mais elle n’en reste pas moins importante au regard de l’autonomie qu’elle nous confère.
La mise en œuvre de la politique de souveraineté alimentaire nous impose une politique de production audacieuse au terme de laquelle chaque année on doit réaliser des réserves substantielles pour se mettre à l’abri d’éventuelles contre-performances.
Cette politique requiert le recours à des mécanismes de garantie à concevoir au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire. Il pourrait s’agir de faire rémunérer les excédents de production par un organisme de financement approprié: caisse de stabilisation etc…
Les considérations qui précèdent semblent montrer la nécessité de retourner à nos anciennes habitudes alimentaires.
Il s’agirait de s’investir dans une politique de recherche pour introduire au niveau de l’irrigué les spéculations traditionnelles adaptées à nos conditions climatologiques:
Sorgho, Niébé, Petit Mil, Maïs, etc…
2 – L’engagement des Parties :
L’objectif de souveraineté alimentaire ne peut être réalisé sans la réunion de préalables qui engagent toutes les parties au processus de production que sont l’État, les agriculteurs et les transformateurs.
Il s’agit pour l’État d’assurer en permanence la protection de la production nationale contre un commerce interlope tout au long de nos frontières, de réduire les importations lorsqu’il y a une adéquation relative entre l’offre et la demande par une politique de taxation avisée.
L’état octroie également des subventions et exonérations dans le cadre de l’acquisition de matériels et produits liés à l’activité agricole.
L’Etat assure un accompagnement phytosanitaire que nous trouvons insuffisant.
Il assure également une lutte anti-aviaire appréciable.
En amont de l’activité agricole proprement dite l’état procède à la viabilisation et à l’aménagement d’espaces adaptés au développement des diverses spéculations.
Toujours dans le cadre de sa politique d’appui aux agriculteurs l’État fait couvrir ces programmes sociaux par le rachat auprès des transformateurs (usiniers) d’une part de leur production.
Les agriculteurs, en contrepartie des efforts de l’État, améliorent leur production de sorte que le consommateur soit satisfait.
Pour mesurer l’effort que consentent les usiniers, un regard sur le processus de financement des campagnes agricoles est nécessaire.
Le cumul des emblavures des deux saisons rizicoles est de 85000 hectares en moyenne.
Les charges consécutives à l’exploitation d’un hectare se situent entre 500 000 et 600 000 MRO. Le crédit agricole de Mauritanie (CAM) intervient à hauteur de 2 milliards seulement.
Les usiniers consacrent à ce niveau 40 milliards au financement des deux campagnes.
Ils suppléent ainsi aux agriculteurs qui ne peuvent réunir les conditions d’éligibilité au crédit. On reconnaît toutefois que ces transactions d’utilité notable sont insuffisamment encadrées au plan réglementaire. Mais force est de reconnaître qu’elles constituent à tous égards la moelle substantifique de l’activité agricole.
Certains agriculteurs autofinancent leur production à hauteur de 40% couvrant la main d’œuvre et le carburant.
En attendant la mise en place d’un écosystème financier performant, il importe d’encadrer ce processus de financement de manière à protéger les petits et moyens agriculteurs contre les aspects léonins que peut renfermer cette approche de gestion informelle.
3 – Les grands problèmes :
L’activité agricole dont on reconnaît désormais quelle constitue, en raison de ses implications sociales et économiques, un axe majeur de notre politique de développement, mérite une attention particulière. Elle connaît des problèmes d’ordre structurel et fonctionnel qui risqueraient à terme d’en émousser l’élan si rien n’est fait pour leur apporter une solution convenable.
a – Problèmes d’ordres structurels :
On note l’absence d’un régime foncier adapté aux exigences d’un développement économique à la dimension des potentialités dont recèlent le pays et intégrant les impératifs d’équilibres sociaux. Ainsi valorisés, les domaines pourraient opportunément servir de garantie à toutes les transactions qu’impose l’exploitation agricole.
On peut souligner également l’absence d’un écosystème financier adapté au besoin des investissements en équipements agricoles et de couverture des campagnes.
b – Problèmes d’ordre fonctionnel :
On déplore l’absence d’une politique énergétique adaptée aux nécessités d’extension des zones d’exploitation et de réduction des charges.
A ce niveau l’électrification généralisée des zones de production pourrait constituer une bonne option en ce qu’elle réduirait de 33 % les charges d’exploitation.
Pour cela, il conviendrait de brancher les casiers rizicoles à la basse tension, l’exploitant ne prenant en charge que ses consommations.
Il y a lieu d’assurer le transport de la ressource hydrique à travers des chenaux pour atteindre des vallées fossiles afin de permettre d’étendre davantage les zones exploitables. Une telle opération devrait réduire les déséquilibres sociaux actuellement perceptibles en même temps qu’elle atténuerait la pression sur les terres de la basse vallée.
Quelques problèmes d’aménagement subsistent, dont entre autres la mise à niveau des anciens aménagements rizicoles collectifs et individuels.
Aussi l’introduction de nouveaux aménagements au profit des collectivités villageoises du Gorgol du Brakna et du Guidimakha se révèle nécessaire au regard des déficits visibles à ce niveau.
La revitalisation des axes hydrauliques naturels éprouvés par un processus de désertification accéléré est d’urgence avérée.
Le curage des axes hydrauliques existants s’impose avec acuité. Un mécanisme de prise en charge efficient devrait être mis en place. Car les tardivetés à ce niveau sont de nature à impacter négativement les rendements au regard des perturbations qu’elles entrainent au niveau du processus d’irrigation.
Il convient de réaliser plus d’aménagements horticoles en mettant à profit les terres sablonneuses du Djéri plus adaptées à cette activité. Cela devrait être rendu possible par le transport au plus loin de la ressource hydrique désormais techniquement faisable. Cette opération est d’autant plus opportune qu’elle permettrait la récupération très avantageuse des 16 milliards de mètre cube d’eau libérés annuellement dans l’océan pour les nécessités de sécurisation des endiguements du delta du fleuve.
Pour Parer à d’éventuelles inondations aux conséquences désastreuses il devient urgent de procéder à l’endiguement des zones agricoles du Trarza Est. Cet endiguement devrait être poursuivis jusqu’à l’arrondissement de Dar El Barka au Brakna.
Il conviendrait de soutenir les petites et moyennes exploitations collectives et individuelles par l’introduction subventionnée de procédés modernes d’irrigation et de fertilisation : goutte à goutte, aspersion etc…
On note une insuffisance aiguë au niveau des infrastructures et équipements agricoles. D’où il importe de s’investir dans un programme de mécanisation adapté aux types d’exploitations et professionnalisé. Tous les marchés en offrent une possibilité étendue.
Il y a lieu de mettre en place, en zone de production, des infrastructures de conservation et de transformation.
Procéder à l’aménagement de terminaux dans les ports et aéroports pour l’organisation optimale des activités d’exportation est d’une nécessité impérieuse.
4 – Production, compte d’exploitation et commercialisation :
a – Production :
S’assurer de la disponibilité d’intrants de qualité adaptés aux types d’exploitation (horticulture, riziculture).
Procéder à l’achèvement et à la mise en œuvre du plan d’action relatif à la relance de l’activité semencière
Adapter la disponibilité des semences et intrants aux exigences des calendriers culturaux et itinéraires techniques.
Généraliser la réalisation des études pédologiques des sols. Ce travail permettrait une meilleure spécialisation de ceux-ci en même temps qu’il déterminerait leurs besoins en compléments de fertilisation.
On a annoncé au titre « nécessité d’autonomie » que le tonnage produit, réputé relativement suffisant, était plutôt le fait de l’extension des exploitations. Ce qui, dans les mêmes proportions, laissait croitre les charges. Il conviendrait plutôt de s’engager dans un processus d’exploitation intensive qui, à terme, réaliserait un doublement de production tout en restreignant les surfaces exploitées. La résolution des problèmes posés, en ce qu’elle permet de réaliser les conditions idéales du déroulement de l’activité agricole, permettrait de parvenir à cette fin.
Le relèvement des taux de productivité et de rendement que devrait générer cette démarche, permettrait d’apporter la réponse idoine au problème posé.
b- Les Comptes d’Exploitation :
Les comptes d’exploitation constituent un répertoire des charges et produits liés à la production. Leur élaboration rigoureuse s’impose pour avoir une appréciation juste des efforts consentis par les différents intervenants.
Aussi importe-t-il de les élaborer selon un format de contexture compatible avec les exigences du plan comptable national.
Les comptes d’exploitation comportent une série de variables dont les changements ne peuvent être motivés que par des évolutions tarifaires justifiées.
Les taux de productivité et de rendement font intervenir des données difficilement généralisables dont entre autres le respect des bonnes pratiques agricoles.
L’appréciation de ces taux nécessite une large concertation entre les parties impliquées, abstraction faite de tout unilatéralisme.
Aussi nous pouvons constater que l’état actuel de suffisance relative est plutôt le fait de l’extension des emblavures et non de la productivité.
La tendance à faire de cet état de fait un élément d’atténuation des charges est à reconsidérer. En effet l’extension des emblavures pourrait être de nature à obérer les charges.
c – commercialisation :
Il est urgent de mettre en place une autorité de régulation qui définit les besoins globaux par spéculation, s’assure de l’effectivité de la production, participe à la mise en œuvre des mécanismes de distribution et régule le marché.
Il recherche également les opportunités d’exportation.
D’ores et déjà il est indispensable de protéger le marché contre l’envahissement d’étrangers au détriment de producteurs nationaux qui subissent de plein fouet une concurrence déloyale.
- Les inondations et leurs effets
Les inondations intervenues pendant la saison hivernale dernière ont négativement impacté la campagne agricole.
Les wilayas riveraines du fleuve ont enregistré des dommages considérables.
La longue immersion de certains périmètres a été d’effets dévastateurs sur les aménagements.
On constate des ruptures totales ou partielles des endiguements, ouvrages et réseaux d’irrigation nécessitant, selon les cas, des travaux de confortation ou de reconstruction.
Les dégâts ont été si importants qu’ils pourraient compromettre ou retarder les campagnes, si l’on ne prenait pas à temps des mesures à la dimension de l’urgence avérée.
L’intervention de l’Etat est vivement recommandée pour pallier ou, à tout le moins, réduire les effets induits de l’absence d’un écosystème financier répondant aux besoins d’une activité majeure.
A cet effet les exploitations privées quelle qu’en soit la taille pourraient recevoir un appui proportionné aux dommages dûment constatés. Cela leur permettrait de couvrir au moins les charges de campagne et faire face aux besoins de relance d’une activité très éprouvée.
Les coopératives villageoises affectées et démunies au point de ne pouvoir acquitter leur redevance pourraient tout simplement en être libérées à travers une prise en charge généreuse dont les modalités devraient être définies en fonction du mode d’acquisition.
Il faudrait reconnaître que, du point de vue social, ce déficit drastique constitue un sujet de préoccupation majeure.
Tous les périmètres devraient, pour éviter de connaitre des ruptures au niveau du processus de production, obtenir un appui en termes de confortation et de réhabilitation.
Les périmètres inondés encore sous l’eau ou marécageux, du moins pour beaucoup d’entre eux, ne seront véritablement pas en état d’être repris avant la fin du mois de janvier prochain.
Il va s’en dire qu’aucun travail de réhabilitation ne peut être envisagé avant la fin du mois de février.
Une réduction des emblavures est à prévoir ; ce qui serait de nature à minorer la production nationale au titre de la prochaine contresaison.
En effet les contraintes du calendrier ne manqueront pas de nous imposer la mise en jachère de certains périmètres.
Pour juguler ou au moins limiter les effets d’une telle éventualité, il conviendrait de susciter, puis d’appuyer l’ouverture de contresaisons au Brakna et au gorgol. Les espaces indiqués y sont disponibles.
Conclusion :
L’agriculture ne peut être perçue comme une activité lucrative seulement. Elle constitue plutôt une réponse à un besoin de souveraineté alimentaire de valeur stratégique.
L’adage ne dit-il pas qu’un pays incapable de se nourrir par ses moyens propres reste fortement tributaire de ceux qui lui procurent ses moyens de subsistance.
La Mauritanie peut se mettre à l’abri d’une telle situation. En effet elle dispose d’énormes potentialités agricoles jusqu’ici sous exploitées.
Il faut cependant se rendre à l’évidence qu’elle ne peut, du fait des aléas multiples auxquels elle est assujettie, se développer sans un soutien décisif de l’État. Ce soutien se décline à travers de fortes subventions et incitations qui sont de nature à lui assurer une attirance suivie de la part des investisseurs, nationaux notamment.
L’objectif de souveraineté alimentaire inscrit au plan d’action de l’État ne peut avoir de contenu concret en l’absence d’efforts tangibles et multiformes s’étendant au financement et à la création d’espaces socioéconomiques adaptés.
L’autosuffisance alimentaire que sous-tend cette politique est à portée de main. En effet aujourd’hui le cumul des productions saisonnières au titre d’une année en riz couvre largement les besoins de celle-ci. C’est de toute évidence une avancée spectaculaire. Mais ce n’est pas, loin sans faut, un signe d’autosuffisance. En fait il y a autosuffisance quand, en plus de la satisfaction du besoin annuel, il existe une réserve de sécurité d’au moins 3 ans pouvant être mise en consommation lorsque des conditions particulières d’imprévisibilité l’imposent.
Cela fait intervenir nécessairement des mécanismes de prévoyance exceptionnels que le CSA devrait être apte à organiser.
Les producteurs nationaux devraient mener leur activité de façon régulière et constante sans se soucier des contraintes du marché sachant que les excédents dans tous les cas de figure seront rémunérés.
Nous ne partageons pas le sentiment de ceux qui pensent que la faveur dont bénéficie l’agriculture est excessive et qu’elle devrait être reconsidérée.
Cela procède d’une méconnaissance totale de cette activité hautement protégée partout ailleurs dans le monde.
Il est vrai que l’État consent des efforts méritoires à ce niveau mais ils restent tout de même à améliorer au regard de l’importance des enjeux.